Antony Blinken s’entretient avec Ariel Henry et appelle à une transition urgente
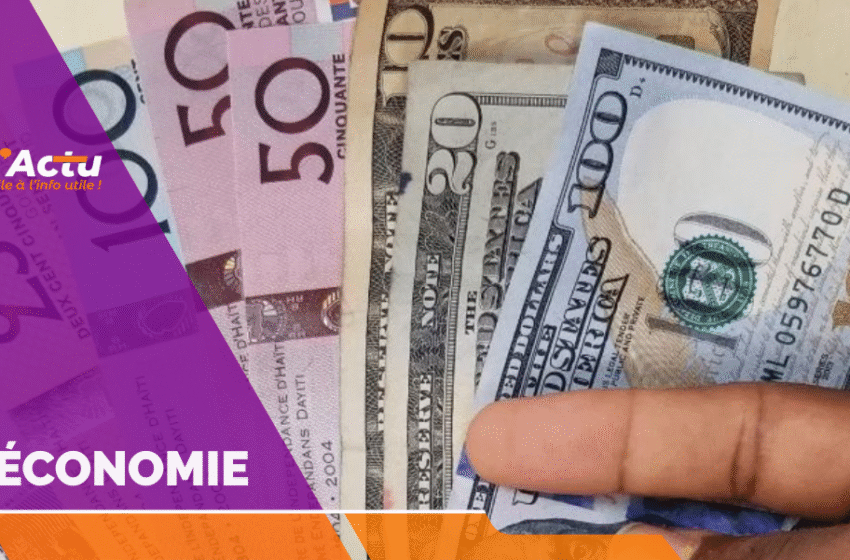
Haïti face au défi de la double circulation monétaire : la BRH tire la sonnette d’alarme
La Banque de la République d’Haïti (BRH) a publié un nouveau document intitulé « Double circulation monétaire : identification des risques », dans lequel elle examine les causes, les conséquences et les dangers liés à la coexistence du dollar américain et de la gourde dans l’économie nationale. Ce phénomène, signe d’une dollarisation partielle, fragilise la politique monétaire, accentue la dépréciation de la gourde et menace la stabilité financière du pays.
Une économie dominée par deux monnaies
Depuis plus de trois décennies, Haïti vit sous un régime de double circulation monétaire, caractérisé par l’usage simultané de la gourde et du dollar américain dans les transactions commerciales, les dépôts bancaires et, parfois même, le paiement des salaires.
Selon la BRH, cette situation trouve ses racines dans des déséquilibres structurels : instabilité socio-politique chronique, inflation persistante, dépréciation accélérée de la monnaie nationale, dépendance accrue aux transferts de la diaspora et ouverture commerciale importante.
Ces facteurs ont progressivement érodé la confiance des agents économiques dans la gourde, jugée trop instable. Le dollar américain s’est alors imposé comme une monnaie refuge, utilisée à la fois comme unité de compte, moyen de paiement et réserve de valeur.
Les transferts de la diaspora : moteur et paradoxe
Les transferts sans contrepartie, notamment ceux envoyés par la diaspora, représentent désormais près de 17 % du PIB en 2024, selon la BRH.
Ce flux massif de devises étrangères contribue à la stabilité financière du pays, tout en alimentant paradoxalement la dollarisation.
Pour mieux encadrer ce secteur, la Banque centrale a instauré, via la circulaire n°114-1, le paiement des transferts en gourdes, au taux de référence du jour. Cette mesure vise à protéger les bénéficiaires contre les taux abusifs pratiqués par certaines maisons de transfert, tout en préservant la disponibilité en dollars sur le marché local.
Des risques majeurs pour l’économie nationale
La dollarisation partielle comporte de nombreux risques : elle réduit l’efficacité de la politique monétaire, complique la lutte contre l’inflation et accroît la vulnérabilité du système financier.
Lorsque les dépôts et les prêts sont libellés en dollars, alors que les revenus demeurent en gourdes, les agents économiques s’exposent à des risques de solvabilité en cas de nouvelle dépréciation de la monnaie nationale.
La BRH souligne également qu’en 2024, près de 66 % des dépôts bancaires sont libellés en devises étrangères une situation qui limite sa capacité d’intervention et affaiblit son rôle de prêteur en dernier ressort.
Des pistes de sortie : vers une dédollarisation progressive
Pour inverser la tendance, la Banque centrale s’inspire d’expériences réussies, notamment celles du Vietnam et du Pérou, où la stabilisation macroéconomique, la discipline budgétaire et le ciblage de l’inflation ont permis de réduire la dépendance au dollar.
En Haïti, la BRH a déjà pris plusieurs mesures :
- facturation des cartes de crédit en gourdes,
- interdiction des prêts à la consommation en dollars,
- émission d’obligations BRH destinées à encourager l’épargne en monnaie locale.
Mais l’institution reconnaît que ces efforts demeureront insuffisants sans stabilité politique, discipline fiscale, réformes structurelles et restauration de la confiance du public dans la gourde.
Restaurer la confiance dans la gourde : un enjeu national
La BRH conclut que la résorption de la dollarisation passe par une stratégie coordonnée, combinant politique monétaire rigoureuse, modernisation du système financier et relance des secteurs exportateurs.
Redonner de la valeur à la gourde, c’est aussi rétablir la souveraineté économique d’Haïti et réduire sa vulnérabilité face aux chocs externes.


